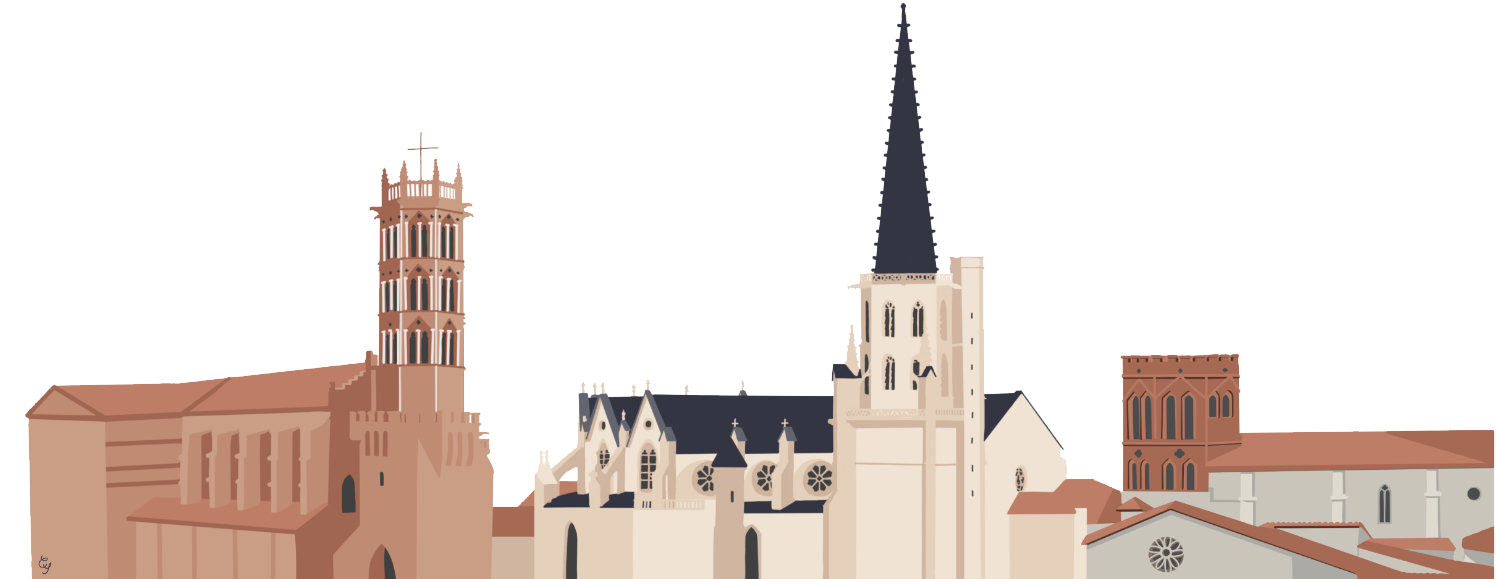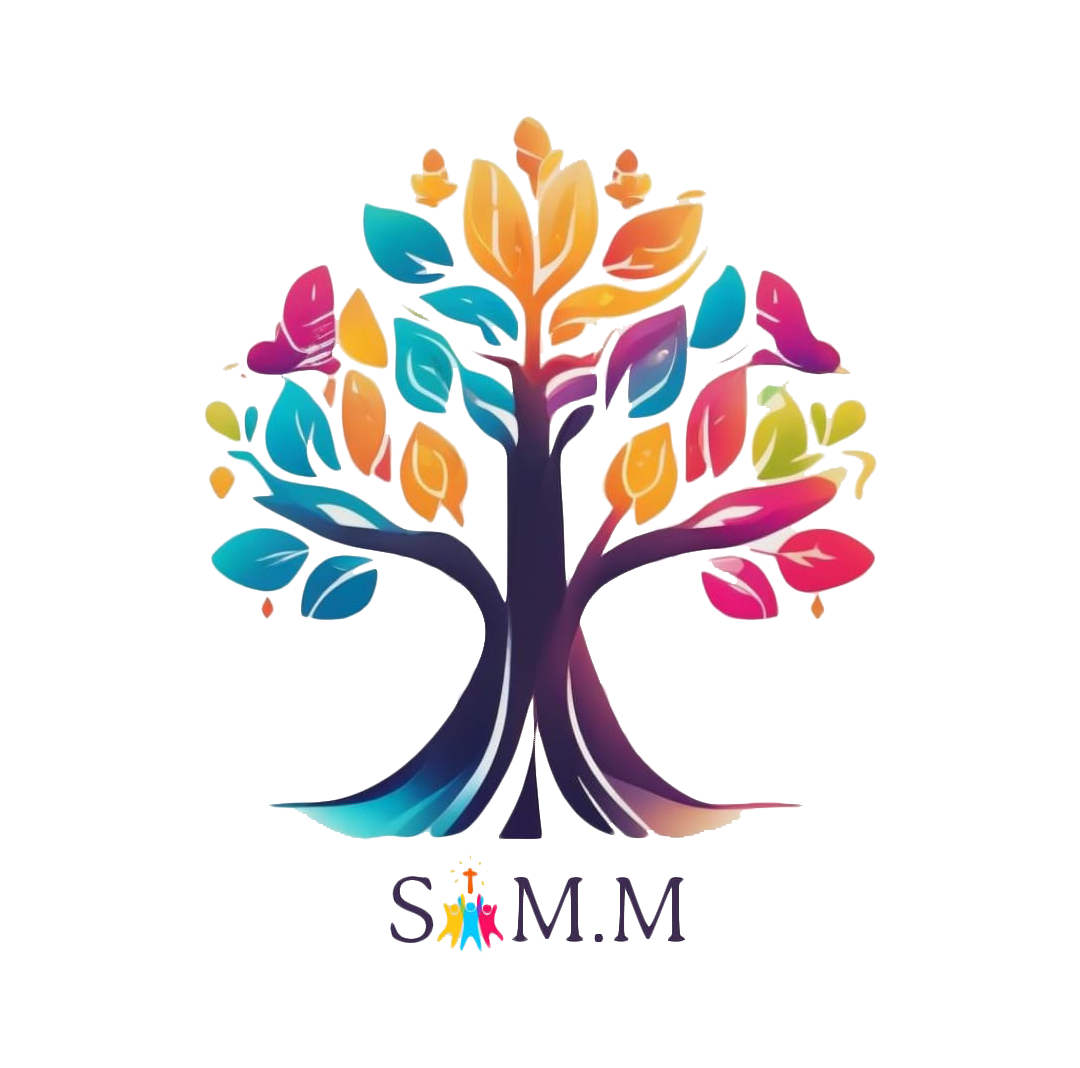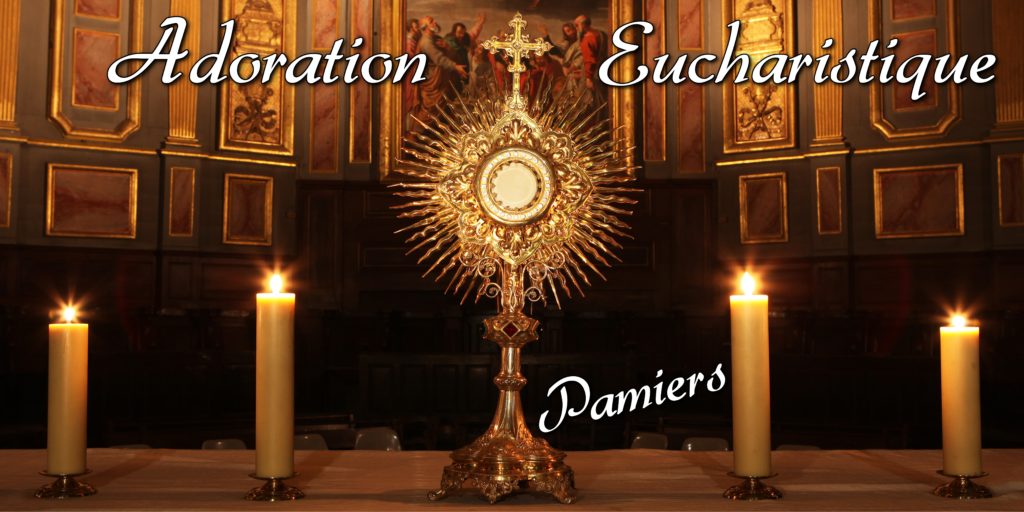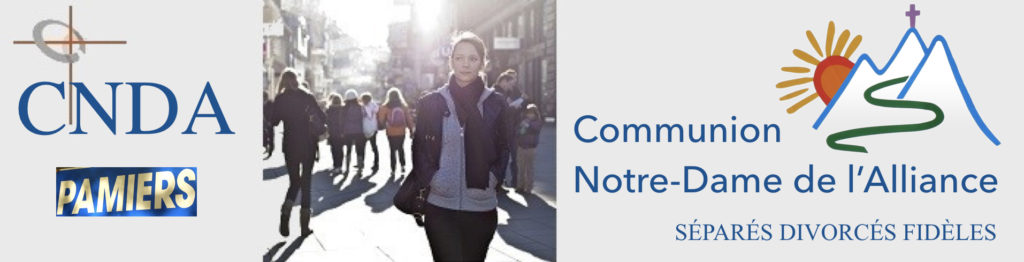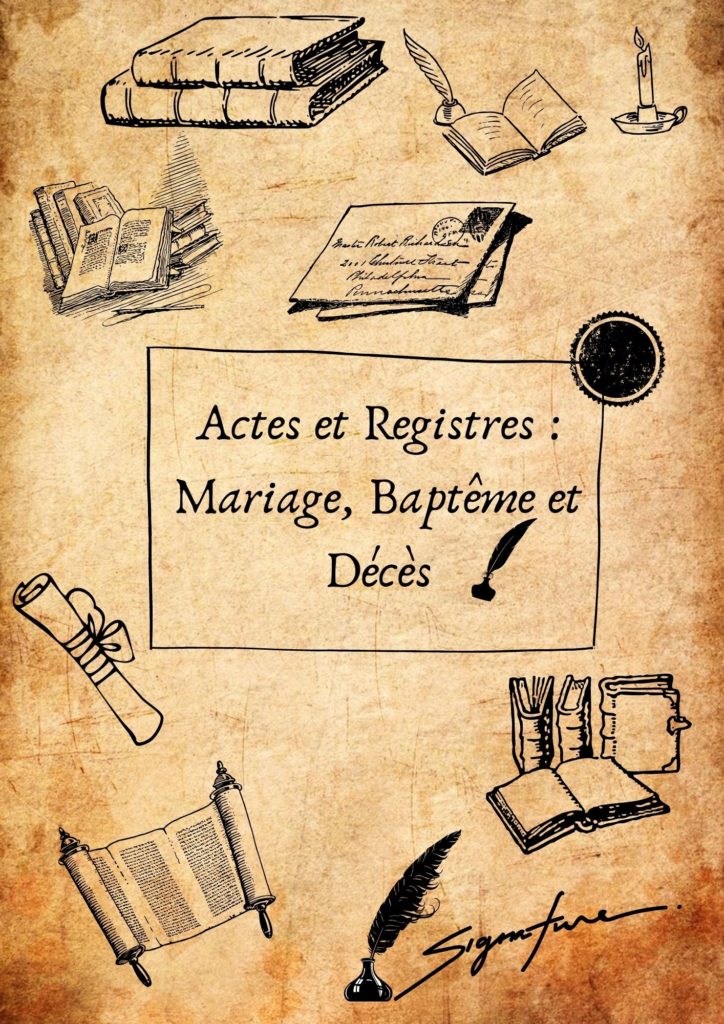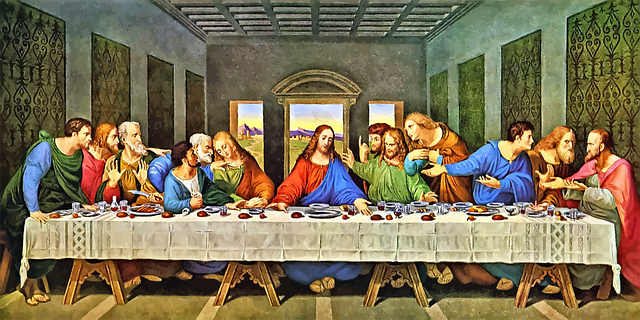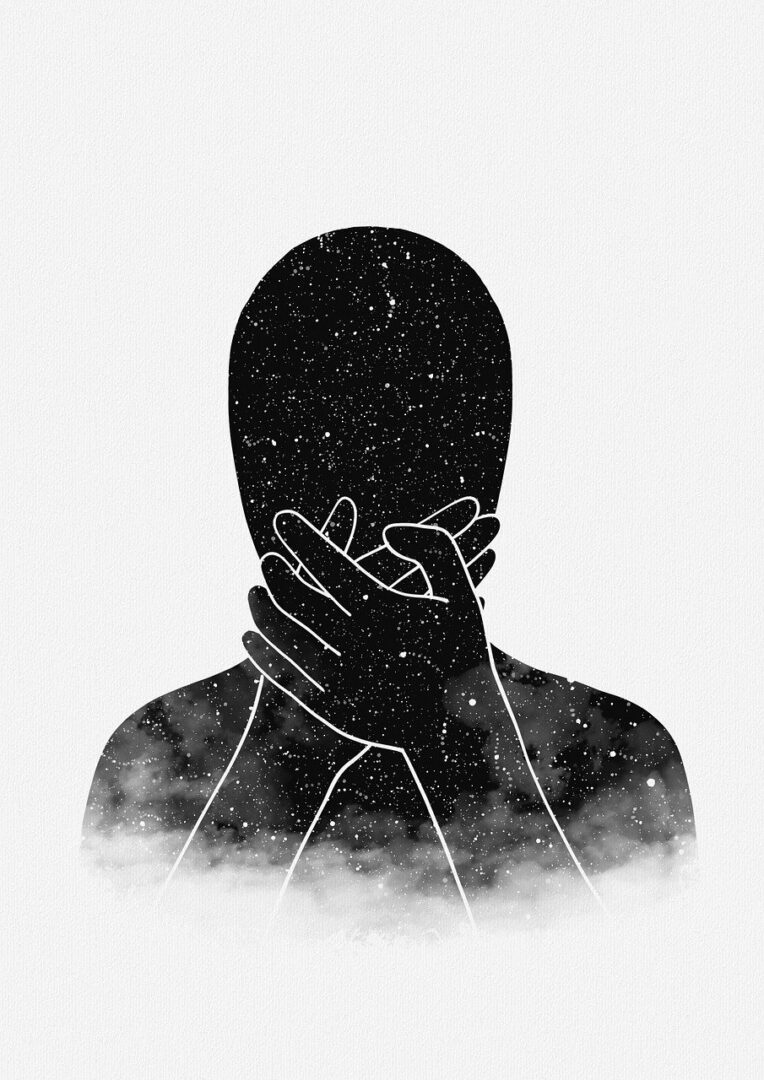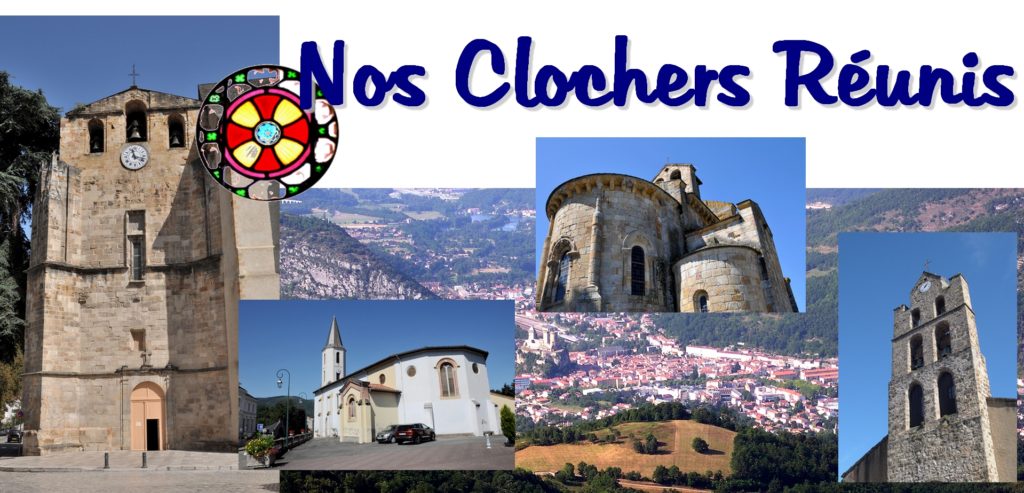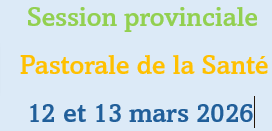Avec trois penseurs, imaginer le jour d’après…
Il n’est pas aisé de trier parmi les nombreuses réflexions qui nous sont proposées autour des changement auquel notre monde et l’Église seront invités, à la suite de cette épisode pandémique. Pour vous aider nous avons choisi de donner la parole à un philosophe (Edgar Morin), un économiste (Gaël Giraud), et un Théologien (Tomás Halík ), susceptibles de stimuler notre réflexion. Ces choix sont évidemment subjectifs, mais assumés !
Que revele cette crise ? en 7 points. (Edgar Morin)
 En tant que crise planétaire, elle met en relief la communauté de destin de tous les humains en lien inséparable avec le destin bio-écologique de la planète Terre ; elle met simultanément en intensité la crise de l’humanité qui n’arrive pas à se constituer en humanité.
En tant que crise planétaire, elle met en relief la communauté de destin de tous les humains en lien inséparable avec le destin bio-écologique de la planète Terre ; elle met simultanément en intensité la crise de l’humanité qui n’arrive pas à se constituer en humanité.
En tant que crise économique, elle secoue tous les dogmes gouvernant l’économie et elle menace de s’aggraver en chaos et pénuries dans notre avenir.
En tant que crise nationale, elle révèle les carences d’une politique ayant favorisé le capital au détriment du travail, et sacrifié prévention et précaution pour accroître la rentabilité et la compétitivité.
En tant que crise sociale, elle met en lumière crue les inégalités entre ceux qui vivent dans de petits logements peuplés d’enfants et parents, et ceux qui ont pu fuir pour leur résidence secondaire au vert.
En tant que crise civilisationnelle, elle nous pousse à percevoir les carences en solidarité et l’intoxication consumériste qu’a développées notre civilisation, et nous demande de réfléchir pour une politique de civilisation.
En tant que crise intellectuelle, elle devrait nous révéler l’énorme trou noir dans notre intelligence, qui nous rend invisibles les évidentes complexités du réel.
En tant que crise existentielle, elle nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins, nos vraies aspirations masquées dans les aliénations de la vie quotidienne, faire la différence entre le divertissement pascalien qui nous détourne de nos vérités et le bonheur que nous trouvons à la lecture, l’écoute ou la vision des chefs-d’œuvre qui nous font regarder en face notre destin humain.
Et surtout, elle devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat, le secondaire et le frivole, sur l’essentiel : l’amour et l’amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté et la solidarité de nos « je » dans des « nous », le destin de l’Humanité dont chacun de nous est une particule. En somme, le confinement physique devrait favoriser le déconfinement des esprits. »
Gaël Giraud: «Il est temps de relocaliser et de lancer une réindustrialisation verte de l’économie française»
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN (Eugénie Bastié)
Gaël Giraud est économiste. Ex-économiste en chef de l’Agence Française de Développement (AFD), professeur à l’Ecole nationale des Ponts Paris Tech, directeur de recherche au CNRS, il est également prêtre jésuite.
 FIGAROVOX. – Le président de la République Emmanuel Macron, élu sur un programme libéral, semble avoir fait un virage à 180° assumant de soutenir l’économie en crise «quoi qu’il en coûte». Comment analysez-vous ce tournant?
FIGAROVOX. – Le président de la République Emmanuel Macron, élu sur un programme libéral, semble avoir fait un virage à 180° assumant de soutenir l’économie en crise «quoi qu’il en coûte». Comment analysez-vous ce tournant?
Gaël GIRAUD. –Le discours du 12 mars dernier du président de la République reprenait un thème présent depuis longtemps dans ses allocutions — la mise “hors marché” des biens communs, et la santé en est un — et semblait faire un réquisitoire contre sa propre politique. Le sens qu’il convient de donner à une parole est inséparable des actes qui l’accompagnent. Attendons les actes.
On accuse volontiers les «dogmes néolibéraux» ou l’austérité budgétaire d’avoir ruiné les systèmes de santé des pays occidentaux. Cependant on voit aussi que les pays qui s’en sortent le mieux tels la Corée du Sud, Taïwan, Singapour ou l’Allemagne sont aussi ceux qui disposent d’un Etat moderne, de finances publiques saines, d’une industrie puissante. Par railleurs, la France semble dépenser plus que la moyenne des pays de l’UE dans le système de santé. Faut-il vraiment accuser l’austérité?
Un peu de comptabilité nationale ne fait jamais de mal: la contribution des administrations publiques à la valeur ajoutée, et donc au PIB, est de l’ordre de 18,2% en France. Elle n’augmente quasiment pas depuis 1983. Les fameux 56,6% brandis trop souvent proviennent d’une erreur consistant à confondre la valeur ajoutée avec les dépenses de fonctionnement: les dépenses des ménages et des entreprises non financières représentent 150% du PIB mais cela n’inquiète personne, à juste titre, car tout le monde sait que ce ratio n’a pas de sens. Quant à nos dépenses publiques de santé, près des deux tiers alimentent la dépense privée: ce sont des revenus des professionnels de santé libéraux, des cliniques privées et des laboratoires pharmaceutiques.
La Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam (dans une version non-démocratique) démontrent qu’un secteur public puissant étroitement articulé à un secteur industriel qui ne rêve pas de se délocaliser en Chine ou en Europe de l’Est sont les clefs du succès économique et sanitaire.
Alors quelles sont les raisons de notre fiasco sanitaire?
Notre fiasco sanitaire me paraît d’abord dû à une culture comptable qui confond toujours la gestion de “bon père de famille” avec celle d’une Nation: non, la macro-économie n’est pas de la micro-économie élargie car les dépenses des uns y font les revenus des autres (ce qui n’est pas vrai pour un ménage ou une entreprise). Et qui confond gestion intelligente avec réduction toujours et partout de la dépense publique à (très) court terme. Le stock (de masques), la réserve (d’enzymes) ne sont pas des immobilisations inutiles, de l’argent public dormant. Le budget de l’Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS) créé en 2007 a été, depuis lors, divisé par dix. Résultat: par delà les morts, nous allons prendre au moins dix points supplémentaires de ratio dette publique sur PIB (un autre ratio qui n’a pas de sens) et cela fera hélas la démonstration que, jugé à l’aune de ses propres critères, cet “esprit comptable” conduit à sa propre défaite face au réel: la nécessaire explosion de la dépense publique et la destruction partielle de notre appareil productif pour sauver des vies. Mais ce n’est pas aujourd’hui l’heure des comptes. L’urgence est à la solidarité nationale avec nos compatriotes qui meurent chez eux, dans nos hôpitaux ou nos Ehpads et avec tous ceux qui souffriront de séquelles à vie. Cela doit passer par la réquisition des cliniques privées (comme en Espagne), la production de ventilateurs pour sauver des vies (comme aux Etats-Unis), de masques et matériel de dépistage sans lesquels aucun déconfinement ordonné n’est possible.
Si le pacte de stabilité a été suspendu et un effort de relance sans précédent consenti par la BCE, l’obstination des rhéno-flamands à refuser la mutualisation des dettes est toujours là. Comment outrepasser ce blocage? Faut-il que les Etats s’organisent en dehors de l’UE? La zone euro risque-t-elle d’exploser?
Le projet européen sera de plus en plus fortement remis en cause si nous ne nous montrons pas davantage solidaires. Certes, l’Italie a dû acheter le matériel livré par Pékin. Certes, la Saxe accueille des malades italiens. Reste que les Chinois, les Russes et les Albanais semblent faire davantage pour la Lombardie que les riches ouest-Européens. Les 37 milliards d’euros dégagés du budget de l’UE et les 100 milliards de l’initiative SURE prise par la Commission (pour permettre aux gouvernements de compenser les pertes des salariés en chômage partiel et des travailleurs indépendants) sont très insuffisants: nous allons vers des pertes de PIB supérieures à -10%, soit plus de 2000 milliards pour l’Union. C’est l’ordre de grandeur des efforts budgétaires qu’il faut consentir pour raccourcir et alléger la dépression car le confinement réduit l’effet multiplicateur de la dépense.
Christine Lagarde, à raison, encourage l’Union à porter l’effort à 1500 milliards mais, finalement, après des négociations marathon, les ministres européens des finances n’ont réussi à se mettre d’accord que sur 500 milliards. Un début encourageant mais très insuffisant si l’on en reste là. L’assouplissement des règles budgétaires a heureusement permis aux Etats de mobiliser une enveloppe de cette taille mais elle très mal répartie entre pays. En outre, la plus grande part consiste en garanties publiques aux prêts bancaires: or les PME au bord de la faillite ne peuvent guère s’endetter davantage. Elles ont désespérément besoin de liquidité sans contrepartie. Au-delà de la garantie publique, les 45 milliards d’effort budgétaire français sont presque dérisoires. Les 750 milliards de la BCE, quant à eux, risquent de s’avérer inopérants si l’argent reste gelé dans les bilans bancaires comme ce fut le cas lors des précédentes opérations de quantitative easing, ou bien termine en spéculations financières ou encore — ce qui est plus vrai-semblable compte tenu de l’effondrement boursier — dans le financement du pétrole de schiste américain. Il faut donc une dépense budgétaire mutualisée. Nos amis flamands se montrent inflexibles, pour l’instant, alors qu’ils ont un nombre de victimes rapporté à la population égal à celui de la France. L’Allemagne est divisée. Une alliance entre la France et le sud de l’Europe peut convaincre nos amis allemands d’exiger l’émission de 2000 milliards de corona-bonds à taux nul pour financer tout de suite un effort budgétaire inédit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, au passage, sauver l’idée même d’Europe tout en permettant aux investisseurs du monde entier qui sont en train de perdre leur argent sur les marchés financiers d’investir dans l’Europe de demain.
Certains experts américains ont évoqué la possibilité de faire jouer «l’hélicoptère monétaire» en distribuant par exemple 1200 dollars à chaque américain. Cette solution, popularisée notamment par Milton Friedman vous parait-elle bonne pour sortir de la crise sans dilapider l’argent public?
A la différence de 2008, nous avons un effondrement de la demande et de l’offre dans l’économie réelle. C’est là qu’il faut agir. La BCE pourrait refinancer auprès de notre Banque Publique d’Investissement (BPI) une cinquantaine de milliards de dons sans contre-partie faits aux ménages français. Cela permettrait de parer au plus pressé pour payer les loyers, etc. Aucun risque d’inflation dans le contexte actuel, sauf s’il y avait des pénuries de biens essentiels: nous n’avions déjà plus d’inflation (hors immobilier) depuis des années, la dépression ne peut qu’aggraver cette tendance déflationniste. De toutes les manières, compte tenu de l’envolée des dettes, un peu d’inflation serait la bienvenue, à condition que les salaires suivent.
Une des manières d’éviter que l’austérité ne succède à la relance serait d’effacer une partie de la dette publique. Comment est-ce possible sans créer de spéculation monétaire ruineuse et un appauvrissement généralisé de nos économies (on cite souvent le précédent de l’Argentine)?
Depuis 2015, la Banque Centrale Européenne (BCE) a racheté environ 2000 milliards d’euros de dettes souveraines de la zone euro, dont environ 400 milliards de titres français. Décidons ensemble, entre Européens, que nous ne nous rembourserons pas à nous-mêmes cet argent, et utilisons la marge de manœuvre budgétaire dégagée pour financer un vaste plan de reconstruction post-pandémie. La BCE fera des pertes, soit, mais tout le monde sait que ce ne sont pas ses 80 milliards de fonds propres qui assurent la crédibilité de l’euro. Quoi de mieux pour crédibiliser l’euro que de reconstruire l’Europe après la thrombose économique du confinement? Les Traités européens n’obligent pas à recapitaliser Francfort en cas de pertes. Et il sera bien temps, plus tard, de lui donner quelques dizaines de milliards pour reconstituer ses capitaux propres. Quant à l’appauvrissement généralisé, c’est ce qui promet de nous arriver si nous n’inventons pas des solutions audacieuses. Heureusement, dès aujourd’hui, ce qui était impensable hier devient envisageable. Préfère-t-on avoir recours à d’autres expédients plus «classiques» qui, bientôt, cesseront d’être des tabous: emprunt national obligatoire, impôt sur la fortune, progressivité de la fiscalité du capital?
Vous préconisez la création d’emplois par l’Etat pour sortir de la crise. C’est-à-dire? L’Etat doit il employer des chômeurs dans de grands travaux? Dans quels secteurs? Quels sont les précédents dont on pourrait s’inspirer?
Aujourd’hui, 50% de l’industrie et des services français sont à l’arrêt ; 85% du bâtiment. Ce n’est pas mieux ailleurs: malgré sa propagande, l’économie chinoise tourne seulement à 40%. Les Etats-Unis risquent de s’envoler vers 30% de chômeurs au dernier trimestre. L’Inde se prépare à des famines. Il n’y aura donc pas de relais de prospérité à l’extérieur. Le plus urgent, à la sortie du confinement, sera de remettre au travail le plus grand nombre de nos compatriotes: en pratiquant des tests de dépistage aléatoires groupés pour circonscrire les risques de reprise de la contagion, en généralisant le port du masque pour tous et partout, en renforçant de toute urgence notre système sanitaire. Encore faut-il que les salariés d’hier retrouvent un travail. Le chômage partiel permet de freiner l’hémorragie mais nous n’avons pas encore les chiffres de la débâcle en matière d’emplois. Par ailleurs, le COVID19 peut malheureusement devenir une épidémie saisonnière (comme la grippe) et le réchauffement climatique risque de multiplier les pandémies tropicales. Reconduire le «monde d’hier», fondé sur la thermo-industrie et des économies de court terme faites sur le dos des services publics serait irrationnel. Il faut donc profiter du déconfinement pour inaugurer le «monde de demain».
Accélerer la rénovation thermique des bâtiments (publics et privés) et le passage à la voiture électrique pourrait créer beaucoup d’emplois non délocalisables sur tous nos territoires, réduit notre dépendance au pétrole et nos émissions de CO2 tout en améliorant notre balance commerciale. Passer à l’hydrogène dans les autres modes de transports (flottes, bus, camions, trains). Généraliser une agriculture écologique de proximité, plus gourmande en main d’oeuvre, moins polluante et tout aussi productive que l’agro-industrie. Lancer un vrai programme public d’enseignement et de recherche autour de la révolution écologique, de la maternelle jusqu’au CNRS. Reconstruire notre Défense nationale: un chef d’Etat major a été limogé pour avoir osé déclarer que la réduction de son budget ne lui permettait plus d’assurer la protection des Français. Il ne faudrait pas faire, à propos de notre Défense, la même découverte qu’au sujet de notre système sanitaire.
On évoque beaucoup la nécessité de «réindustrialiser» nos économies. Mais les raisons structurelles qui ont poussé à la délocalisation (coût du travail, manque de formation, etc) sont toujours là. A quelles conditions la réindustrialisation est-elle possible? Faut-il mettre en œuvre une forme de protectionnisme? Quels secteurs faut-il réindustrialiser en priorité?
La France devrait échapper au rationnement alimentaire mais nous devons tout de même tirer les leçons de notre fragilité: les chaînes d’approvisionnement internationales à flux tendus, sans stocks et sans redondance, nous rendent beaucoup trop vulnérables. Même l’extraordinaire afflux sur les réseaux sociaux, la Toile et les visioconférences doit nous interroger: les entreprises qui fournissent ces services numériques ne sont pas européennes et se révèlent peu fiables.
La stratégie de délocalisation industrielle n’avait déjà plus de sens avant la pandémie: depuis 2009, la Chine réoriente sa production sur le bassin asiatique, laisse filer ses salaires et ne recycle plus ses excédents commerciaux dans la sphère financière occidentale. La balance commerciale de l’Occident avec Pékin est à peu près équilibrée. Il est temps de relocaliser et de lancer une réindustrialisation verte de l’économie française. Cette crise doit devenir notre moment gaullien. Le protectionnisme, quant à lui, a engendré énormément de malentendus. Historiquement, il ne coïncide pas avec la guerre et le libre échange n’est nullement synonyme de paix: peu avant 1870, la France et la Prusse venaient de signer un traité de libre-échange.
« Ne cherchons pas le Vivant parmi les morts. » (Tomás Halík )
…et si les églises vides un peu partout dans le monde au moment de Pâques 2020 étaient un signe de ce qui se produira si nous ne parvenons pas à changer radicalement le visage du christianisme ? Il nous faut aller plus loin, plus profond que l’offre des substituts télévisés qui sont proposés.
 C’est de la République tchèque que nous arrive cette profonde réflexion : Tomás Halik, son auteur (né en 1948), est professeur de sociologie à l’Université Charles de Prague, président de l’Académie Chrétienne Tchèque et aumônier de l’université. Pendant le régime communiste, il a été actif dans l’« Église clandestine ». Il est lauréat du Prix Templeton et docteur honoris causa de l’Université d’Oxford.
C’est de la République tchèque que nous arrive cette profonde réflexion : Tomás Halik, son auteur (né en 1948), est professeur de sociologie à l’Université Charles de Prague, président de l’Académie Chrétienne Tchèque et aumônier de l’université. Pendant le régime communiste, il a été actif dans l’« Église clandestine ». Il est lauréat du Prix Templeton et docteur honoris causa de l’Université d’Oxford.
Notre monde est malade. Je ne fais pas seulement référence à la pandémie du coronavirus, mais à l’état de notre civilisation, tel qu’il se révèle dans ce phénomène mondial. En termes bibliques : c’est un signe des temps.
Au début de ce temps de Carême inhabituel, nombre d’entre nous pensaient que cette épidémie allait provoquer une panne généralisée de courte durée, une rupture dans le fonctionnement habituel de la société, que nous allions surmonter d’une manière ou d’une autre, et que bientôt tout rentrerait dans l’ordre comme cela était auparavant.
Ce ne sera pas le cas. Et cela ne se passerait pas bien si nous essayions. Après cette expérience globale, le monde ne sera plus le même qu’avant, et il ne devrait probablement plus l’être.
Lors de grandes calamités, il est naturel de se préoccuper d’abord des besoins matériels pour survivre ; mais « on ne vit pas que de pain ». Le temps est venu d’examiner les implications plus profondes de ce coup porté à la sécurité de notre monde. L’inévitable processus de la mondialisation semblerait avoir atteint son apogée : la vulnérabilité générale d’un monde global saute maintenant aux yeux.
L’Église comme hôpital de campagne
Quel genre de défi cette situation représente-t-elle pour le christianisme et pour l’Église – un des premiers « acteurs mondiaux » – et pour la théologie ?
L’Église devrait être un « hôpital de campagne », comme le pape François le propose.
Par cette métaphore, le pape veut dire que l’Église ne doit pas rester dans un splendide isolement loin du monde, mais doit se libérer de ses frontières et apporter de l’aide là où les gens sont physiquement, mentalement, socialement et spirituellement affligés.
Oui, c’est comme cela que l’Église peut se repentir des blessures infligées tout récemment par ses représentants aux plus faibles.
Mais essayons de réfléchir plus profondément à cette métaphore, et de la mettre en pratique.
Si l’Église doit être un « hôpital », elle doit bien sûr offrir les services sanitaires, sociaux et caritatifs qu’elle a offerts depuis l’aube de son histoire. Mais en tant que bon hôpital, l’Église doit aussi remplir d’autres tâches. Elle a un rôle de diagnostic à jouer (en identifiant les « signes des temps »), un rôle de prévention (en créant un « système immunitaire » dans une société où sévissent les virus malins de la peur, de la haine, du populisme et du
nationalisme) et un rôle de convalescence (en surmontant les traumatismes du passé par le pardon).
Les églises vides : un signe et un défi
L’an dernier, juste avant Pâques, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé ; cette année, pendant le Carême, il n’y a pas de services religieux dans des centaines de milliers d’églises sur plusieurs continents, ni dans les synagogues et les mosquées.
En tant que prêtre et théologien, je réfléchis à ces églises vides ou fermées comme un signe et un défi de Dieu.
Comprendre le langage de Dieu dans les événements de notre monde exige l’art du discernement spirituel, qui à son tour appelle un détachement contemplatif de nos émotions exacerbées et de nos préjugés, ainsi que des projections de nos peurs et de nos désirs.
Dans les moments de désastre, les « agents dormants d’un Dieu méchant et vengeur » répandent la peur et en font un capital religieux pour eux-mêmes. Leur vision de Dieu a apporté de l’eau au moulin de l’athéisme pendant des siècles.
En temps de catastrophes, je ne vois pas Dieu comme un metteur en scène de mauvaise humeur, assis confortablement dans les coulisses des événements de notre monde, mais je le vois plutôt comme une source de force, opérant chez ceux qui font montre de solidarité et d’amour désintéressé dans de telles situations – oui, y compris ceux qui n’ont pas de « motivation religieuse » pour leur action.
Dieu est amour humble et discret.
Mais je ne peux m’empêcher de me demander si le temps des églises vides et fermées n’est pas une sorte de vision nous mettant en garde sur ce qui pourrait se passer dans un avenir assez proche : c’est à cela que pourrait ressembler dans quelques années une grande partie de notre monde.
N’avons-nous pas déjà été avertis par ce qui se passe dans de nombreux pays où de plus en plus d’églises, de monastères et de séminaires se vident et ferment leur porte ? Pourquoi avons-nous pendant si longtemps attribué cette évolution à des influences externes (« le tsunami séculier ») au lieu de comprendre qu’un autre chapitre de l’histoire du christianisme arrive à son terme et qu’il est temps de se préparer pour un nouveau ?
Cette époque de vide dans les bâtiments d’église révèle symboliquement peut-être la vacuité cachée des Églises et leur avenir probable, à moins qu’elles ne fassent un sérieux effort pour montrer au monde un visage du christianisme totalement différent.
Nous avons beaucoup trop cherché à convertir le « monde » (« le reste »), et beaucoup moins à nous convertir nous-mêmes – pas une simple « amélioration », mais un changement radical de l’« être chrétien » statique en un « chrétien-en-devenir » dynamique.
Quand l’Église médiévale a fait un usage excessif des interdits comme sanction et que ces « grèves générales » de toute la machine ecclésiastique signifiaient que les services religieux n’avaient plus lieu et que les sacrements n’étaient plus administrés, les gens ont commencé à rechercher de plus en plus une relation personnelle avec Dieu, une « foi nue ».
Les fraternités laïques et le mysticisme se sont multipliés. Cet essor du mysticisme a sans aucun doute contribué à ouvrir la voie à la Réforme – non seulement celle de Luther et de Calvin mais aussi la réforme catholique liée aux Jésuites et au mysticisme espagnol.
Peut-être que la découverte de la contemplation pourrait aider à compléter la « voie synodale » vers un nouveau concile réformateur.
Un appel à la réforme
Nous devrions peut-être accepter l’actuel sevrage des services religieux et du fonctionnement de l’Église comme un kairos, une opportunité pour nous arrêter et nous engager dans une réflexion approfondie devant Dieu et avec Dieu. Je suis convaincu que le temps est venu de réfléchir à la manière de poursuivre le mouvement de réforme que le pape François dit être nécessaire : non des tentatives de retour à un monde qui n’existe plus, ni un recours à de simples réformes structurelles externes, mais plutôt un changement vers le coeur de l’Évangile, « un voyage dans les profondeurs ».
Je ne vois pas en quoi une solution succincte sous forme de substituts artificiels, comme la télédiffusion de messes, serait une bonne solution à l’heure où le culte public est interdit. Le passage à la « piété virtuelle », à la « communion à distance » et à la génuflexion devant un écran de télévision est vraiment quelque chose de bizarre.
Nous devrions peut-être plutôt tester la vérité des paroles de Jésus : là où deux trois personnes sont réunies en mon nom, je suis avec elles.
Pensions-nous vraiment répondre au manque de prêtres en Europe en important des « pièces de rechange » pour la machinerie de l’Église à partir d’entrepôts apparemment sans fond en Pologne, en Asie et en Afrique ?
Nous devons bien sûr prendre au sérieux les propositions du synode sur l’Amazonie, mais nous devons simultanément accorder plus de place au ministère des laïcs dans l’Église ; n’oublions pas que, dans de nombreux territoires, l’Église a survécu sans clergé pendant des siècles entiers.
Peut-être que cet « état d’urgence » est un révélateur du nouveau visage de l’Église, dont il existe un précédent historique. Je suis persuadé que nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos congrégations, nos mouvements d’église et nos communautés monastiques devraient chercher à se rapprocher de l’idéal qui a donné naissance aux universités européennes : une communauté d’élèves et de professeurs, une école de sagesse, où la vérité est recherchée à travers le libre débat et aussi la profonde contemplation. De tels îlots de spiritualité et de dialogue pourraient être la source d’une force de guérison pour un monde malade.
La veille de l’élection papale, le cardinal Bergoglio a cité un passage de l’Apocalypse dans lequel Jésus se tient devant la porte et frappe. Il a ajouté : Aujourd’hui le Christ frappe de l’intérieur de l’Église et veut sortir. Peut-être est-ce ce qu’il vient de faire.
Où est la Galilée d’aujourd’hui ?
Depuis des années, je réfléchis au texte bien connu de Friedrich Nietzsche sur le « fou » (le fou qui est le seul à pouvoir dire la vérité) proclamant « la mort de Dieu ». Ce chapitre s’achève par le fait que le fou va à l’église pour chanter « requiem aeternam deo » et demande : « Après tout, que sont vraiment ces églises sinon les tombeaux et les sépulcres de Dieu ? » Je dois bien admettre que pendant longtemps plusieurs aspects de l’Église me paraissaient de froids et opulents sépulcres d’un dieu mort.
Il semble que de beaucoup de nos églises seront vides à Pâques cette année. Nous lirons ailleurs les passages de l’évangile sur le tombeau vide.
Si le vide des églises évoque le tombeau vide, n’ignorons pas la voix d’en-haut : « Il n’est pas ici. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. »
Une question pour stimuler notre méditation pendant cette Pâques étrange : Où se trouve la Galilée d’aujourd’hui, où nous pouvons rencontrer le Christ vivant ?
Les recherches sociologiques indiquent que dans le monde le nombre de « résidents » (à la fois ceux qui s’identifient totalement avec la forme traditionnelle de la religion et ceux qui affirment un athéisme dogmatique) diminue alors que le nombre de « chercheurs » augmente. En outre, il y a bien sûr un nombre croissant d’« apathéistes », des gens qui se moquent des questions de religion ou de la réponse traditionnelle qu’on leur donne.
La principale ligne de démarcation n’est plus entre ceux qui se considèrent croyants et ceux qui se disent non-croyants. Il existe des « chercheurs » parmi les croyants (ceux pour qui la foi n’est pas un « héritage » mais un « chemin »), comme parmi les « non-croyants » qui, tout en rejetant les principes religieux proposées par leur entourage, ont cependant un désir ardent de quelque chose pour satisfaire leur soif de sens.
Je suis convaincu que « la Galilée d’aujourd’hui », où nous devons rechercher Dieu, qui a survécu à la mort, c’est le monde des « chercheurs ».
À la recherche du Christ parmi les chercheurs
La Théologie de la Libération nous a enseigné à chercher le Christ parmi ceux qui sont en marge de la société. Mais il est aussi nécessaire de le chercher chez les personnes marginalisées au sein de l’Église, parmi ceux « qui ne nous suivent pas ». Si nous voulons nous connecter avec eux comme disciples de Jésus, nous allons devoir abandonner beaucoup de choses.
Il nous faut abandonner bon nombre de nos anciennes notions sur le Christ. Le Ressuscité est radicalement transformé par l’expérience de la mort. Comme nous le lisons dans les Évangiles, même ses proches et ses amis ne l’ont pas reconnu. Comme l’apôtre Thomas, nous n’avons pas à prendre pour argent comptant les nouvelles qui nous entourent. Nous pouvons persister à vouloir toucher ses plaies. En outre, où serons-nous sûrs de les rencontrer sinon dans les blessures du monde et les blessures de l’Église, dans les blessures du corps qu’il a pris sur lui ?
Nous devons abandonner nos objectifs de prosélytisme. Nous n’entrons pas dans le monde des chercheurs pour les « convertir » le plus vite possible et les enfermer dans les limites institutionnelles et mentales existantes de nos Églises. Jésus, lui non plus, n’a pas essayé de ramener ces « brebis égarées de la maison d’Israël » dans les structures du judaïsme de son époque. Il savait que le vin nouveau doit être versé dans des outres nouvelles.
Nous voulons prendre des choses nouvelles et anciennes dans le trésor de la tradition qui nous a été confié et les faire participer à un dialogue avec les chercheurs, un dialogue dans lequel nous pouvons et devons apprendre les uns des autres. Nous devons apprendre à élargir considérablement les limites de notre compréhension de l’Église.
Il ne nous suffit plus d’ouvrir magnanimement une « cour des gentils ». Le Seigneur a déjà frappé « de l’intérieur » et est sorti – et il nous appartient de le chercher et de le suivre. Le Christ a franchi la porte que nous avions verrouillée par peur des autres. Il a franchi le mur dont nous nous sommes entourés. Il a ouvert un espace dont l’ampleur et l’étendue nous donne le tournis.
Au seuil même de son histoire, l’Église primitive des Juifs et des païens a vécu la destruction du temple dans lequel Jésus priait et enseignait à ses disciples. Les Juifs de cette époque ont trouvé une solution courageuse et créative : ils ont remplacé l’autel du temple démoli par la table familiale juive et la pratique du sacrifice par celle de la prière privée et communautaire. Ils ont remplacé les holocaustes et les sacrifices de sang par le « sacrifice des lèvres » : réflexion, louange et étude des Écritures.
À peu près à la même époque, le christianisme primitif, banni des synagogues, a cherché une nouvelle identité propre. Sur les décombres des traditions, les Juifs et les Chrétiens apprirent à lire la Loi et les prophètes à partir de zéro et à les interpréter à nouveau. Ne sommes-nous pas dans une situation similaire de nos jours ?
Dieu en toutes choses
Quand Rome est tombée au début du Ve siècle, il y a eu une explication instantanée de plusieurs côtés : les païens y ont vu un châtiment des dieux à cause de l’adoption du christianisme, tandis que les chrétiens y ont vu une punition de Dieu adressée à Rome, qui avait continué à être la prostituée de Babylone. Saint Augustin a rejeté ces deux explications : à cette époque charnière il a développé sa théologie du combat séculaire entre deux « villes » adverses, non pas entre les chrétiens et les païens, mais entre deux « amours » habitant le coeur de l’homme : l’amour de soi, fermé à la transcendance (amor sui usque ad contemptum Deum) et l’amour qui se donne et trouve ainsi Dieu (amor Dei usque ad contemptum sui). La période actuelle de changement de civilisation n’appelle-t-elle pas une nouvelle théologie d’histoire contemporaine et une nouvelle compréhension de l’Église ?
« Nous savons où est l’Église, mais nous ne savons pas où elle n’est pas » nous a enseigné le théologien orthodoxe Evdokimov. Peut-être ce que le dernier concile a dit sur la catholicité et l’oecuménisme doit-il acquérir un contenu plus profond ?
Le moment est venu d’élargir et d’approfondir l’oecuménisme, d’avoir une « recherche de Dieu en toutes choses » plus audacieuse.
Nous pouvons, bien sûr, accepter ce Carême aux églises vides et silencieuses comme une simple mesure temporaire brève et bientôt oubliée. Mais nous pouvons aussi l’accueillir comme un « kairos », un moment opportun « pour aller en eau plus profonde » et rechercher une nouvelle identité pour le christianisme dans un monde qui se transforme radicalement sous nos yeux.
La pandémie actuelle n’est certainement pas la seule menace globale à laquelle notre monde va être confronté aujourd’hui et dans le futur.
Accueillons le temps pascal qui arrive comme un défi pour rechercher à nouveau le Christ. Ne cherchons pas le Vivant parmi les morts. Cherchons-le avec audace et ténacité, et ne soyons pas surpris s’il nous apparaît comme un étranger. Nous le reconnaîtrons à ses plaies, à sa voix quand il nous parle dans l’intime, à l’Esprit qui apporte la paix et bannit la peur.
Tomás Halík